Santé et audition.
Les aides auditives réduisent de moitié le déclin cognitif chez les personnes âgées malentendantes présentant un risque de déclin cognitif.

Ces dernières années, plusieurs études ont mis en évidence un lien entre la perte auditive et les troubles cognitifs, notamment la démence. Une analyse parue dans le journal scientifique « The Lancet » a identifié la perte d’audition comme le principal facteur de risque modifiable pour le développement de la démence.
L’étude clinique ACHIEVE, actuellement dirigée par un spécialiste en ORL à l’Université Johns Hopkins aux États-Unis, est le plus grand essai clinique à ce jour explorant les bénéfices potentiels des aides auditives sur le déclin cognitif chez les personnes âgées ayant une perte auditive.
Cette étude, menée sur une période de trois ans aux États-Unis, a inclus des participants âgés de 70 à 84 ans, souffrant d’une perte auditive légère à modérée non traitée et ne présentant pas de troubles cognitifs sévères. Les résultats, publiés dans The Lancet, révèlent que le déclin cognitif est réduit de moitié chez les personnes malentendantes qui utilisent des aides auditives depuis trois ans.
Selon le spécialiste, la perte auditive est facilement traitable à un âge avancé, tout comme d’autres facteurs de risque de démence tels que l’hypertension, l’isolement social, et l’inactivité physique. Il souligne que les stratégies pour diminuer le risque de démence devront probablement être diversifiées. De plus, l’étude montre que l’utilisation d’aides auditives améliore la communication, la socialisation, et réduit la solitude.
Il est conseillé aux personnes âgées de faire contrôler régulièrement leur audition et de traiter les problèmes auditifs de manière appropriée pour maintenir leur santé et bien-être.
Sources
- F. Lin et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2011 ; doi : 10.1093/gerona/glr115
- G. Livingston et al. The Lancet, 2020 ; doi : 10.1016/S0140-6736(20)30367-6
- F. Lin et al. The Lancet, 2023 ; doi : 10.1016/S0140-6736(23)01406-X
- Communiqué de presse de l’Alzheimer’s Association International Conference : https://aaic.alz.org/
releases_2023/hearing-aids-slow-cognitive-decline.asp
Acouphènes : un dysfonctionnement anormal.
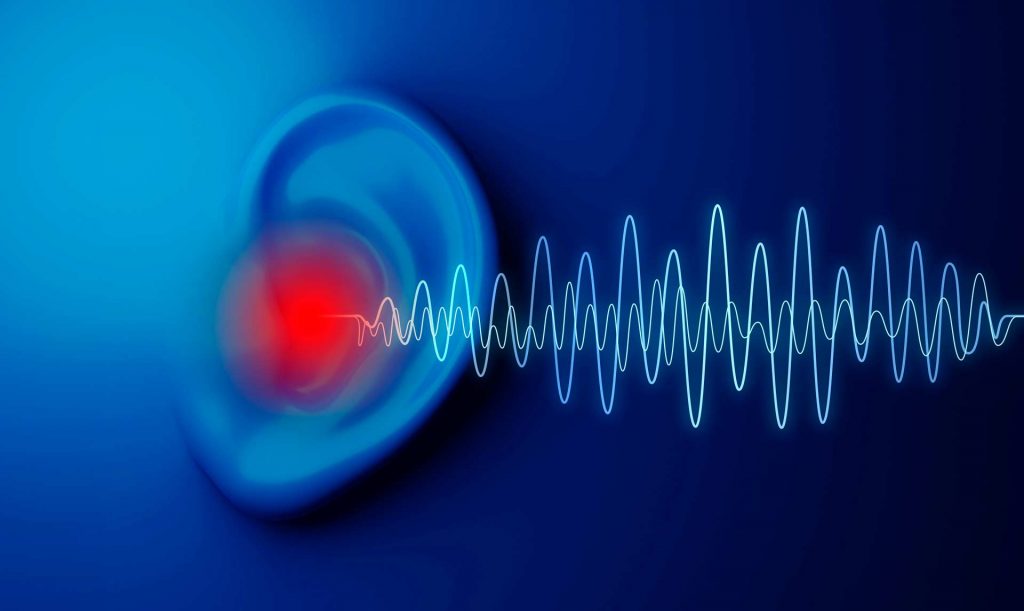
Les acouphènes se manifestent par des sons générés de manière spontanée dans le système auditif, sans origine externe. Leur apparition est souvent liée à une perte d’audition. Les chercheurs s’efforcent de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents afin de proposer des solutions efficaces et durables aux patients les plus touchés.
Un trouble touchant 1 adulte sur 10.
Deux principaux facteurs de risque : la perte auditive liée à l’âge et les traumatismes sonores (exposition au bruit). Des pistes thérapeutiques sont en développement.
Comprendre les acouphènes.
Les acouphènes se manifestent par des sifflements, des grésillements ou des bourdonnements d’oreilles, sans provenance extérieure. Ils peuvent être ressentis dans une seule oreille (unilatéraux) ou dans les deux (bilatéraux), de façon continue ou intermittente, temporaire ou persistante. Un acouphène est considéré comme aigu lorsqu’il est récent et présent plusieurs heures par jour, et devient chronique s’il dure plus de trois mois.
Environ 10 % de la population adulte serait affectée par ce trouble auditif, dont l’impact varie considérablement d’une personne à l’autre, allant d’une simple gêne à un handicap sévère au quotidien. Les formes très invalidantes représentent moins de 1 % des cas. Les acouphènes peuvent causer des difficultés à s’endormir ou à se concentrer, et induire des états d’anxiété et de dépression. Un cercle vicieux peut se former, où l’anxiété liée aux acouphènes amplifie leur perception et aggrave la gêne.
Origine des acouphènes.
La majorité des acouphènes sont d’origine neurosensorielle, résultant de dysfonctionnements au sein de la voie auditive, pouvant survenir à tous les niveaux, de l’oreille jusqu’au cortex. Le plus souvent, ils sont liés à des lésions ou à des dysfonctionnements de l’oreille interne ou des fibres nerveuses auditives. Environ 80 % des cas d’acouphènes sont associés à une perte d’audition. Même en l’absence de déficit détecté à l’audiogramme, des lésions indétectables des fibres nerveuses auditives peuvent exister. Les acouphènes peuvent également s’accompagner d’hyperacousie, une sensibilité accrue aux sons.
Face à une déficience auditive, le cortex auditif met en place des mécanismes de compensation qui peuvent devenir dysfonctionnels. Des activités anormales le long de la voie auditive peuvent être interprétées comme des sons par le système nerveux central, sans stimulation acoustique extérieure. Ces signaux sont alors perçus comme des bruits désagréables, voire insupportables : c’est l’acouphène.
Il existe également un lien entre acouphènes et émotions, le cortex auditif interagissant avec l’amygdale, une région cérébrale impliquée dans les émotions, qui attribue une valeur positive ou négative aux sons. Si un son est jugé désagréable, l’amygdale amplifie sa perception par le cortex auditif, qui le traite alors comme un signal d’alerte, entraînant une réaction de stress avec des manifestations physiologiques.
Facteurs de risque.
Le risque d’acouphènes augmente avec l’âge et la perte auditive généralement associée (presbyacousie), atteignant son maximum autour de 65 ans, bien que l’âge moyen d’apparition soit d’environ 47 ans. Ce risque est également accru par l’exposition au bruit et les traumatismes sonores, car les niveaux sonores élevés peuvent détruire de manière irréversible les cellules de l’oreille interne. Environ un quart des cas d’acouphènes sont liés à un traumatisme sonore chronique, souvent associé à des activités professionnelles bruyantes. Une étude sur des disc-jockeys a révélé que 75 % d’entre eux souffraient d’acouphènes.
D’autres événements, tels que des interventions chirurgicales, des inflammations dues à des otites, des neuropathies, des médicaments ototoxiques ou des problèmes vasculaires près du nerf auditif, peuvent également augmenter le risque d’acouphènes. Cependant, dans près de 40 % des cas, la cause demeure inconnue et leur apparition semble spontanée.
Soulagement possible.
Bien que les acouphènes entraînent une forte demande médicale, aucun traitement curatif n’existe actuellement. La prise en charge vise à masquer les acouphènes pour atténuer la gêne et améliorer le vécu des patients.
Un acouphène peut être accompagné d’une perte d’audition aussi minime soit-elle. Pour diminuer l’intensité de l’acouphène, il suffit de redonner à la personne une audition la plus proche de l’oreille parfaite. En faisant cela, la personne enrichit son environnement sonore, et retrouve l’audition de sons très faibles qu’elle ne percevait pas avant. Cette correction auditive permet d’inhiber le mécanisme physiologique de l’acouphène. Instantanément, dès que l’appareil auditif est placé sur l’oreille, le niveau d’intensité de l’acouphène baisse, jusqu’à parfois disparaitre
De plus, ré-entendre de nouveaux sons, enrichir l’environnement sonore, aide à détourner l’attention que la personne porte à son acouphène. N’oubliez pas : « L’acouphène se nourrit de l’attention que vous lui portez ».
Rien de tel que de masquer un son avec un autre son… Alors si vous avez une perte d’audition, aussi minime soit elle, la solution passe par la correction auditive.
Les masqueurs d’acouphène.
De nos jours, il existe des prothèses auditives spécialisées pour les acouphènes de très bonne qualité. Ils combinent la correction auditive ( retrouver une audition parfaite) et un masqueur d’acouphènes. Un masqueur est un son généré par la prothèse auditive pour masquer les acouphènes. Il peut être de différente nature :
- musique fractale (sons apaisants, relaxants, ressemblant à des notes d’instrument de musique, avec un enchainement aléatoire, dont on ajuste le rythme, le volume, la tonalité et la sonorité)
- sons de la nature (vagues sur la plage, vent dans la forêt, cascade de rivière, etc…)
- sons stables de différentes bandes de fréquence
Les personnes ont le contrôle sur la présence, le volume et le type de sons masquants. Ils sont accès à un choix immense de possibilités. Il leur suffit de choisir ce qu’ils préfèrent.
Pour encore plus de choix de sons masquants, les appareils auditifs sont reliés en bluetooth avec les téléphones cellulaires. L’audioprothésiste vous téléchargera des applications regorgeant de multiples sons masquants, ce qui vous donnera un éventail de choix
Des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) peuvent également être proposées pour aider le patient à mieux gérer ses acouphènes. Ces approches incluent une variété de techniques pour gérer le stress, distraire l’attention et reformuler des pensées négatives. Plusieurs études ont démontré l’efficacité des TCC dans la gestion des acouphènes, tant à moyen qu’à long terme.
D’autres techniques de relaxation, comme la sophrologie, l’hypnose ou la méditation, peuvent également aider à atténuer la perception négative des acouphènes, bien que les résultats soient variables. La thérapie sonore utilise des « masqueurs d’acouphènes » pour réduire la sensibilité aux sons, en émettant un bruit de fond modéré. Ce traitement à long terme nécessite plusieurs mois, et son efficacité reste modérée par rapport à d’autres interventions.
En cas d’anxiété ou de dépression, une prise en charge psychologique et la prescription de médicaments peuvent être bénéfiques, réduisant ainsi l’intensité des acouphènes et la gêne associée.
Enjeux de la recherche :
Des recherches sont en cours pour mieux comprendre les mécanismes physiologiques des acouphènes, essentiel pour mieux caractériser ce trouble et découvrir de nouveaux traitements. Plusieurs pistes préventives et thérapeutiques sont explorées.
Réduction des risques liés aux traumatismes sonores :
Étant donné le lien entre troubles auditifs et acouphènes, améliorer la prévention et le traitement des pertes auditives pourrait diminuer l’incidence des acouphènes. Une approche prometteuse consiste à traiter les traumatismes sonores, en administrant un traitement protecteur dans les heures suivant un traumatisme pour atténuer le risque d’acouphènes.
Neuromodulation pour soulager : plusieurs approches à l’étude :
Différentes stratégies de modulation de l’activité du système nerveux sont évaluées pour améliorer le confort des personnes souffrant d’acouphènes.
Stimulation de la langue :
Une combinaison de thérapie sonore et de stimulation électrique de la langue a montré des résultats prometteurs. Dans une étude, environ 70 % des participants ont signalé une diminution de la sévérité de leurs acouphènes après 12 semaines d’utilisation d’un dispositif approuvé par la FDA.
Stimulation du nerf vague :
Le couplage de thérapie sonore avec des stimulations du nerf vague a également montré des résultats encourageants dans une étude clinique, bien que des vérifications supplémentaires soient nécessaires.
Stimulation électrique transcrânienne :
L’utilisation de la stimulation électrique transcrânienne pourrait également réduire l’intensité des acouphènes, mais des recherches supplémentaires sont requises pour confirmer son efficacité.
Dossier réalisé en collaboration avec Jean-Luc Puel (unité 1298 Inserm/Université de Montpellier, Institut des neurosciences de Montpellier).